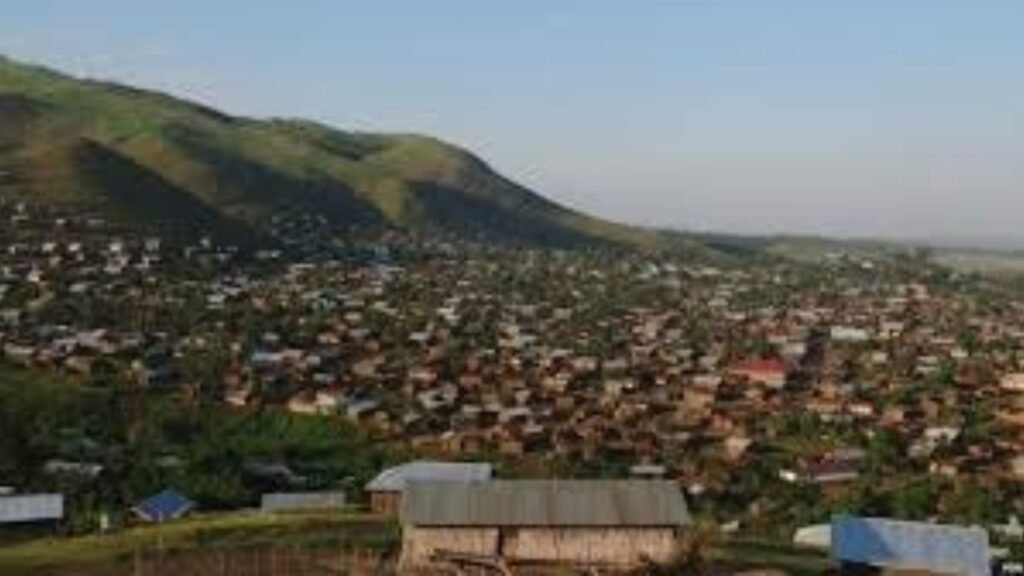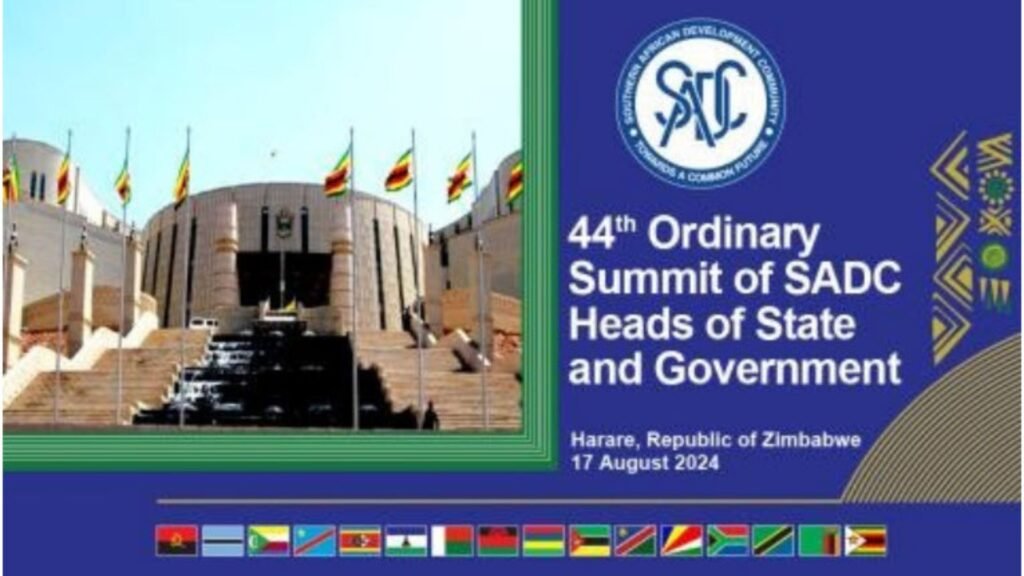Rutshuru : Lutter contre l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière d’héritage
Résumé L’inégalité entre les hommes et les femmes en matière d’héritage à Rutshuru est un problème urgent qui nuit non seulement aux droits des femmes, mais également à la cohésion sociale. Les pratiques coutumières patriarcales continuent de contrecarrer l’application des lois qui devraient garantir l’égalité, engendrant tensions et conflits au sein des familles. Pour restaurer l’égalité des droits, un plaidoyer efficace et des actions concrètes sont essentiels. En agissant de manière concertée et déterminée, nous pouvons restaurer l’égalité entre les hommes et les femmes lors du partage de l’héritage à Rutshuru, pour une société plus juste et équitable pour tous. L’éradication de ces inégalités est non seulement une question de justice sociale, mais également un impératif pour le développement harmonieux de la communauté. Analyse de contexte Dans le territoire de Rutshuru, en République démocratique du Congo (RDC), l’inégalité entre les hommes et les femmes concernant l’héritage demeure un enjeu majeur, profondément enraciné dans des pratiques coutumières patriarcales. Bien que le Code de la famille de la RDC garantisse des droits égaux aux hommes et aux femmes en matière d’héritage, la réalité sur le terrain est tout autre. Les femmes héritières sont souvent privées de leurs droits légaux au profit des hommes, ce qui souligne un écart alarmant entre la loi et la pratique. Par exemple, des enquêtes menées dans la région indiquent que près de 70 % des femmes héritières ne reçoivent pas leur part d’héritage en raison de la pression sociale et des menaces exercées par les membres masculins de la famille. Dans un cas documenté, une femme de Rutshuru a été contrainte de renoncer à son héritage de terres familiales au profit de ses frères, malgré son droit légal. De telles situations illustrent comment les pratiques coutumières, souvent soutenues par des interprétations traditionnelles de la loi, peuvent engendrer des inégalités flagrantes et des violences domestiques. Les conséquences de cette inégalité ne se limitent pas seulement aux femmes héritières. Elles créent également des tensions au sein des familles et au sein de la communauté, alimentant un climat de méfiance et de conflit. Les femmes, en cherchant à protéger leurs droits, sont souvent amenées à dissimuler des ressources ou à entrer en conflit avec leurs belles-familles, ce qui fragilise les relations interpersonnelles et nuit à la cohésion sociale. Recommandations Sensibilisation des communautés Organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits égalitaires des femmes en matière d’héritage, en mettant en avant les dispositions du Code de la famille de la RDC. Utiliser des témoignages de femmes ayant subi des injustices pour illustrer la nécessité de changement. Renforcement des capacités Former les autorités coutumières et judiciaires sur l’application des lois égalitaires en matière d’héritage. Des ateliers pratiques peuvent être mis en place pour les sensibiliser aux droits des femmes et à la nécessité de respecter ces droits. Mécanismes de médiation Établir des plateformes de médiation et de résolution des conflits familiaux liés au partage de l’héritage. Ces mécanismes doivent privilégier le dialogue et la compréhension mutuelle, impliquant des leaders communautaires et des femmes héritières pour assurer une représentation équitable. Participation active des femmes Promouvoir la participation active des femmes héritières dans les processus de décision concernant l’héritage. Cela pourrait inclure la création de groupes de défense des droits des femmes qui travaillent avec les autorités pour garantir que leurs voix soient entendues et respectées. Suivi et évaluation Mettre en place un système de suivi et d’évaluation pour mesurer l’impact des interventions sur l’égalité des droits en matière d’héritage, en recueillant des données sur les cas d’héritage et les résolutions de conflits. Policy Brief – Août 2023